 Image by Today is a good day via Flickr
Image by Today is a good day via Flickr
"Le LBO est un dispositif technique qui permet à une société A d'acquérir une société B en finançant une partie de cette acquisition par un endettement anticipant sur les résultats à venir de la société B.
Ce dispositif repose donc sur au moins le maintien du résultat positif habituel de la société -cible. La gestion du besoin en fonds de roulement en est la clef et constitue souvent un puissant levier d'amelioration des societes reprises en LBO : meilleure gestion des stocks, revue des delais de paiement des fournisseurs, gestion active des creances clients. Avec la crise, ces 3 variables sont beaucoup plus difficiles a gérer" Cité de l'article de Denis Bonzy, vers un nouveau choc financier d'ampleur . Cf. vernimmen.
Ce type de montages financiers ne semble pas apparement poser de probleme si :
Les cash flow et les marges de manœuvre dégagées par les cibles et les montages sont suffisants pour absorber un éventuel « trou d’air » avant l’échéance de la dette bancaire d’acquisition.
Les cash flows : (vernimmen)
Cash flow, au pied de la lettre, signifie flux de trésorerie.Mais dans la pratique il y a quasiment autant de définitions du cash flow que de sociétés ! La tendance est cependant à la normalisation des appellations dont les principales sont : Le cash flow from operations ou le flux de trésorerie d’exploitation que l’on trouve dans le tableau des flux de trésorerie publié maintenant par la quasi-totalité des entreprises cotées. Il correspond à : résultat net + dotations nettes aux amortissements et aux provisions sur actifs immobilisés- plus-values de cession d'actifs+ moins-values de cession d'actifs- variation du besoin en fonds de roulement= Flux de trésorerie d’exploitationC’est effectivement un flux de trésorerie ; il n’est pas tout à fait purement d’exploitation car il inclut les frais financiers, mais à une époque d’endettement et de taux d'intérêt relativement faibles, ce défaut est mineur. Il sert surtout en analyse financière.Le free cash flow ou flux de trésorerie disponible correspond au flux de trésorerie généré par l’actif économique (operating assets), flux qui est ensuite réparti entre ceux qui ont financé cet actif économique, à savoir les actionnaires et les prêteurs (banques et obligataires). Il se calcule ainsi : excédent brut d’exploitation (EBITDA)- impôt normatif sur le résultat d’exploitation (EBIT)- variation du besoin en fonds de roulement- investissements nets des désinvestissements= Flux de trésorerie disponibleC’est un flux de trésorerie on ne peut plus pur qui est utilisé en évaluation pour calculer la valeur d’une entreprise à partir d’un discounted cash flow (DCF) ou modèle d’actualisation des flux de trésorerie. On l’appelle aussi parfois cash flow to firm.
Les marges de manœuvre :
Il s’agit essentiellement de la trésorerie excédentaire directement utilisable au moment de la mise à disposition des fonds par les créanciers et investisseurs.
Cette trésorerie doit pouvoir être disponible et distribuable, on ne retiendra donc la plupart du temps que la seule trésorerie structurelle, et non la trésorerie dite « BFR » générée par les écarts entre le crédit consenti aux clients et le crédit obtenu aupres des fournisseurs. Il s’agit donc d’une trésorerie propriétaire.
La trésorerie correspond à la capacité de remontée (ce qu’il est possible de faire). Elle doit être également assortie d’une marge de manœuvres comptable suffisante, droits à distribution sur les réserves (ce que l’entreprise est en droit de remonter à ses actionnaires).
Le rôle des marges de manœuvre est fondamental, surtout en période de visibilité économique et financière réduite. Elles permettent d’absorber une insuffisance de rentabilité temporaire.
La problématique des LBO aujourd’hui résulte essentiellement du fait de leur extrême tension, ceux-ci ayant été basés sur des prévisions de cash flow très généreuses, le but étant de maximiser l’effet de levier dégagé par les investisseurs en fonds propres.
L’effet de Levier à dans un premier temps été amplifié par l’appréhension de la quasi intégralité des réserves comptables et financières des cibles et dans un second temps par l’articulation de systèmes d’endettement dont une part importante du remboursement du capital était reporté in fine (au moment de la cession par le fonds ou sponsor).
Si les dettes dites in fine (tranches B, C ou D), étaient initialement étaient initialement relativement minoritaires, l’essentiel de la dette étant amortissable, leur proportion, du fait de l’accroissement de la pression concurrentielle entre banques s’est rapidement inversée, ne laissant plus, ces dernières années, a la part amortissable de la dette d’acquisition, qu’une portion des plus congrue.
L’effondrement des cash flow à partir de 2007, mais surtout 2008 a été d’une telle ampleur que bien souvent, les cibles se sont retrouvées incapables de rembourser les seuls intérêts de la dette d’acquisition (dette sénior).
Le principe prévalant dans l’appréciation du risque des préteurs s’est de fait trouvé largement corrompu. Alors que le remboursement d’une dette doit toujours pouvoir s’effectuer par la capacité de la cible à générer un résultat d’exploitation récurent, suffisant et liquide, les banquiers se sont alors mis à raisonner non plus comme des préteurs, mais comme des investisseurs. L’analyse de la valeur future des cibles prenait alors le pas sur leur capacité de remboursement historique ou prévisionnelle dans un environnement présentant une visibilité raisonnable. La problématique du remboursement de la dette se trouvait des lors reporté au moment de la cession de la cible par les investisseurs en fonds propres.
Cette démarche ne pose pas de problèmes, tant que les valeurs sont toutes orientées à la hausse, ce qui est le cas pour n’importe quel marché spéculatif. Elle devient absurde des lors que la tendance se retourne et que l’on assiste à une raréfaction des liquidités bancaires. Les banques ont en effet des lors tendance à devenir de plus en plus regardantes sur l’affectation de leurs fonds, que les cash flows se font plus discrets et leur prévisionabilité plus aléatoire ; Tout se passe en quelque sorte comme ci le système financier dans son ensemble, emporté par un fort élan d’optimisme généralisé avait créé une multitude de « petits eurotunnels ». L’heure des premières échéances en capital approche. Les renégociations et réétalements de dettes sont de plus en plus difficiles à conclure…..et les banques n’ont pour le moment pas d’autre alternative que fractionner ou reporter les premiers remboursements en capital…. Ce phénomène va aller en s’amplifiant et s’autoalimenter du fait de la dépréciation des encours des dettes séniors au sein des bilans des banques.
Tout se passe en quelque sorte comme ci le système financier dans son ensemble, emporté par un fort élan d’optimisme généralisé avait créé une multitude de « petits eurotunnels ». L’heure des premières échéances en capital approche. Les renégociations et réétalements de dettes sont de plus en plus difficiles à conclure…..et les banques n’ont pour le moment pas d’autre alternative que fractionner ou reporter les premiers remboursements en capital…. Ce phénomène va aller en s’amplifiant et s’autoalimenter du fait de la dépréciation des encours des dettes séniors au sein des bilans des banques.
2009 a été l’année des négociations de pool…. Sur un trimestre difficile, l’essentiel de l’explosion ayant eu lieu à partir d’octobre 2008). les perspectives du secteur pour 2010 sont des plus pessimistes, et l'on peut craindre que si la tendance ne se renverse pas significativement, pourrait fort bien constituer l’année du deuxième choc financier… dont l’ampleur pourrait bien dépasser, tout au moins en Europe, celle des crédits immobiliers à risques américains.


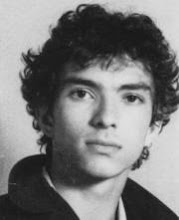
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=acc30e14-65d8-4c42-bba0-ac0845e6e888)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire