Evaluation d’une tpme non cotée - Exercice à risque…..
La différence d’échelle est à l’origine de différences de structures et de comportements.
L’évaluation des PME, voire des TPME constitue un exercice à haut risque pour l’évaluateur, notamment dans le cadre d’une démarche de cession ou de transaction sur capital. On distingue en effet les PME a fort intuitu personae et celles moins marquées au quotidien par la personnalité de leur dirigeant, qui est souvent leur créateur.
La première catégorie de société constitue l’immense majorité des PME. Elles sont souvent de petite taille (moins de 5 M€ de chiffre d’affaires), la croissance de leur volume d’activité est généralement faible voir inexistante. L’approche de leur dirigeant est principalement fiscale et la volonté de création de valeur ne constitue pas un objectif formulé déterminant. L’histoire personnelle de chacune de ces sociétés se répète quasiment à l’identique. On observe une phase de création en entreprise individuelle. Puis une transformation en SARL et pour finir, du fait de l’intégration d’autres sociétés ou de préoccupations de transmission familiales une transformation finale en SAS. Ces sociétés constituent souvent une extension directe du patrimoine privé du dirigeant ; qui conduit souvent l’observateur extérieur à les considérer comme des entreprises individuelles « déguisées en sociétés ». Le volume d’activité est très fréquemment auto limité par les seuils sociaux et la volonté du chef d’entreprise de rester seul aux commandes de son affaire, celui ci intégrant rarement l’intérêt d’ouvrir son capital et d’accepter la moindre dose de dilution et donc un regard extérieur, forcement critique sur sa gestion. Je me suis souvent rendu compte par expérience que les créateurs – animateurs de ces entreprises n’opéraient quasiment jamais une distinction entre l’apport en capital et la contribution opérationnelle à l’activité quotidienne de l’activité. On observe ainsi de fréquents conflits d’actionnaires, dans le cadre de transmission familiales réglées de façons rarement réfléchies d’une part mais également dans le cadre de distorsions d’intérêts entre les apporteurs de capitaux initiaux et les véritables détenteurs du pouvoir au sein de l’entreprise. Ceux ci tolèrent mal les exigences des premiers à bénéficier du partage de valeur au moment de la réalisation. Leurs apports initiaux sont jugés symboliques (ils étaient pourtant souvent indispensable au moment de la création de l’activité). C’est ainsi que très fréquemment, la politique de distribution de dividendes est nulle voire anecdotique, le dirigeant, malgré une fiscalité plus lourde et des risques de redressement bien plus importants, opte pour une politique de distribution de primes, systématisant la construction de son patrimoine personnel au travers de SCI et évitant, tant faire se peu d’extérioriser la rentabilité réelle de son affaire.Au final on se retrouve donc en présence d’entreprises souvent mal organisées ou le chef d’entreprise peut être assimilé à un homme orchestre cumulant à lui seul la responsabilité commerciale, voir la totalité de la relation commerciale, la responsabilité technique, financière comptable et stratégique s’il lui reste du temps. J’ai souvent rencontré de tels chefs d’entreprises qui au final pouvaient cumuler largement plus de 80 heures par semaines avec très peu de périodes d’interruptions tout au long de l’année. On ne peut bien évidemment les blâmer…. Mais le réveil peut s’avérer parfois douloureux quand après une rupture psychologique, ou tout simplement un énorme coup de fatigue, ceux ci décident alors de partir en recherche d’un repreneur…. Leurs enfants leur ayant annoncé leur désintérêt quant à la reprise de l’entreprise familiale.
Valeur prix et besoins personnels du cédant
Il faut alors trouver une valeur….celle ci se confond alors avec la simple notion de prix….. Le candidat à la cession entame un cheminement personnels qui entre le conseil du comptable dont l’intérêt n’est bien sur pas de perdre un client qu’il suit depuis de nombreuses années et qu’il aura tant de mal à remplacer…. Et entre ces besoins immédiats (maintien d’un certain niveau de train de vie, projet d’acquisition immobilière, diverses pensions à servir aux différentes épouses), l’approche du prix formulé pour la cession de l’entreprise n’a que peu à voir avec sa valeur de marché objective….Les méthodes d’évaluation à retenir doivent être simples…. Et facilement appréhensibles par les parties…..La valeur d’actif net corrigé bien sur…… mais que faire de la trésorerie parfois pléthorique et dont la rémunération dans le meilleur des cas n’excède pas 2%. le calcul de la valeur de goodwill ou de fonds de commerce est la aussi particulièrement acrobatique. Il n’est souvent fait aucune référence à un quelconque fonds de commerce au niveau de l’actif.. et pour cause, celui ci crée ex-nihilo par l’entreprise doit être recalculé (en fonction de méthodes de rentabilité qui mixent un certain nombre d’éléments totalement hétérogènes voir hétéroclites et laissent le champ libre à toutes les bizarreries). Comment faire comprendre dans ce cas à un cédant que son nom…. Sa notoriété …. Son savoir faire…. etc. n’ont de valeur qu’a conditions que les éléments mis en œuvre pour les rentabiliser ne dégagent pas un rendement dérisoire, voir négatif….surtout quand on leur répète que le fisc ne connaît que des goodwill à valeur positive.. une entreprise dans ce cas ne pourrait valoir moins que ses fonds propres ajustés à la valeur économique de l’actif….mais comment payer un actif dont la rentabilité est si faible (même après retraitements des sursalaires et autres largesses manageriale) qu’il faudrait pour se faire calculer un plan de financement sur 15 voir 20 ans……On rêve ou plutôt commence le cauchemar pour le cédant, qui s’accompagne parfois des premières manifestation d’agressivité vis à vis de ses conseils et des acquéreurs potentiels.
Le goodwill et les formules magiques
Le calcul du goodwill ou du fonds de commerce, c’est à dire de la capacité de l’affaire à dégager un bénéfice lui permettant d’entamer un processus d’accumulation et de rémunération du capital n’est effectivement pas chose aisée quand elle doit être appliquée à la négociation entre les parties.
Au delà de la panoplie des formules bien connues qui ont le principal avantage d’être connues de facon universelle à défaut d’être reconnues, la seule question qui se pose réellement est : « comment l’affaire peut elle se payer ? ».
L’ensemble de ces formules est globalement dérivée de la même logique que l’on peut résumer ainsi : le rendement de l’actif, à savoir le bénéfice moyen des trois dernières années, éventuellement pondéré est rapporté au rendement du placement de son équivalent monétaire à un taux sans risque. La différence est un profit anormal, la rente du surprofit, qui capitalisé à un taux sorti du chapeau exprime la valeur de cette rente. La sensibilité de ce calcul est toujours importante et dépend du taux de capitalisation ainsi que de l’horizon de capitalisation choisi… on voit immédiatement que malgré son apparente simplicité, ce type de méthode est déconnecté de la valeur économique de l’entreprise en tant que « machine » à produire du profit. La rente sera d’autant plus faible que la valeur de l’actif sera importante. Mais cet actif peut être exprimé par des valeurs économiques et financières très différentes de sa valeur comptable. Le risque réside effectivement dans l’actif, le poste client par exemple n’exprime pas la même valeur selon les modalités de financement qu’il peut offrir. En bref, on n’achete pas identiquement une créance mobilisable et une créance qui ne l’est que difficilement. Son cout de financement est très différent ; l’escompte commercial dans un cas, le découvert ou l’affacturage dans l’autre. Cette problématique est souvent évacuée du calcul du goodwill.
La construction du bénéfice retraité peut également preter à confusion. Les sursalaires constituent la base de leur éllaboration. Encore faut il s’entendre sur ce qu’est au juste un sursalaire. Il n’est pas rare de se retrouver en présence de cédants qui estiment que leur train de vie social doit être completement réintégré dans la capacité bénificiaire de l’affaire. C’est faire fi dans ce cas de la prétention de l’acquerreur à bénéficier d’un traitement normal en tant que salarié dirigeant. Il est vrai que la plupart, ont souvent abandonné des mois voir des années de salaires lors de la création de leur entreprise. Pourquoi un repreneur s’affranchirait il de leur période de galère.
Les puristes de l’évaluation affirmeront avec raison que la seule valeur d’une entreprise réside dans la valeur des cash flow futurs qu’elle est à même de dégager…Comme nous l’avons indiqué, l’approche type DCF est rarement applicable dans le cadre de la PME .
En effet, cette approche suppose l’élaboration d’un business plan précis et réaliste. L’expérience montre que très peu de TPME ont une vision claire de leur avenir proche. Rares sont celles qui en effet établissent des budgets, les décisions d’investissement étant prises intuitivement par un seul homme qui n’a que rarement le temps ou le goût de poser les données de son exploitation et de les projeter dans le temps.
Un repreneur de TPME n’est que rarement enclin à acheter le futur, cette attitude est très compréhensible. Pour lui, il achète un outil en état de marche, le futur lui appartient.
En ce sens, la démarche DCF, hormis de rares exceptions, basées sur des situation de rentes est peu applicable dans le cadre de ce type de négociation.
revenir aux fondamentaux: le financement de la cible
Il ne faut pas oublier qu’au delà des mandants et des divers conseils, le principal interlocuteur du repreneur est son banquier…Il peut donc accepter un prix qui lui semble correctement refléter la valeur de la cible qu’il convoite, encore lui faut il vendre ce prix à son financeur.
Si l’on admet que la durée de financement normale est comprise entre cinq et sept ans. La cible doit dégager suffisamment de ressources pour assurer son entretien (cash flow) ainsi que le prêt de la holding ayant permis d’acquérir son capital. La démarche du preteur est parfois plus restrictive que celle de l’investisseur. Le bénéfice anormal doit être intégralement issu de l’exploitation. Il faut également prévoir une marge de sécurité minimale. On ne peut donc envisager une distribution intégrale des bénéfices. Un rapport de 70% semble être un maximum. Le prêteur n’est pas non plus enclin à seul assumer le risque de l’acquisition. Si l’on considère que les fonds propres investis dans l’opération doivent en assumer le risque, le montage d’une acquisition doit s’entendre avec une part de fonds propres comprise entre 30 à 50%. Il est aisé de calculer la capacité de remboursement de la cible. Si cette capacité est importante et pérenne, c’est à dire si le prix n’est pas excessif, les fonds propres nécessaires seront réduits d’autant. Si le prix est anormalement élevé, cela signifie que la valeur du goodwill est importante. Dans ce cas, soit l’opération n’est pas réalisable, soit la différence, c’est à dire la valeur qu’accorde l’acquerreur à cette acquisition doit être financée par ses apports en fonds propres.
On entend par fonds propres, les apports en capitaux mais également les crédits vendeurs subordonnés ou encore le coupon couru.
Cette méthode est finalement très satisfaisante quoique peu élégante. Elle consiste à déterminer une valeur finançable de façons raisonnable.
Il est alors simple de s’entendre sur un prix. L’expérience montre donc qu’on a toujours intérêt à simplifier les données du problème. Encore faut il pour l’acquéreur avoir le courage de ne pas donner suite à une proposition apparemment attractive, surtout quand notre candidat à l’acquisition en est à sa douzième négociation infructueuse. Ces candidats sont très souvent des cadres quinquagénaires issus de grands groupes. Ceux ci souhaitent reproduire les schémas manageriaux qu’ils ont connu dans leur passé salarié. Ces raisonnements, éloignés de la réalité économique de la PME sont les principaux ennemis du repreneur… en bref, mieux vaut reprendre une petite unité rentable et bien structuré, qu’une cible importante à restructurer. A condition bien sur de maîtriser le métier car ne l’oublions pas, la plupart des PME sont des affaires de sous traitance bâties par des techniciens, rarement par des financiers ou des hommes de marketing.
Lien vers une ressource traitant du sujet:
http://transmission-cession-lbo.typepad.com/blog_sur_le_corporate_fin/2006/03/evaluation_fina.htm


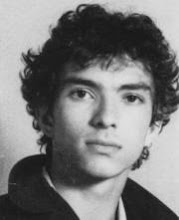
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire